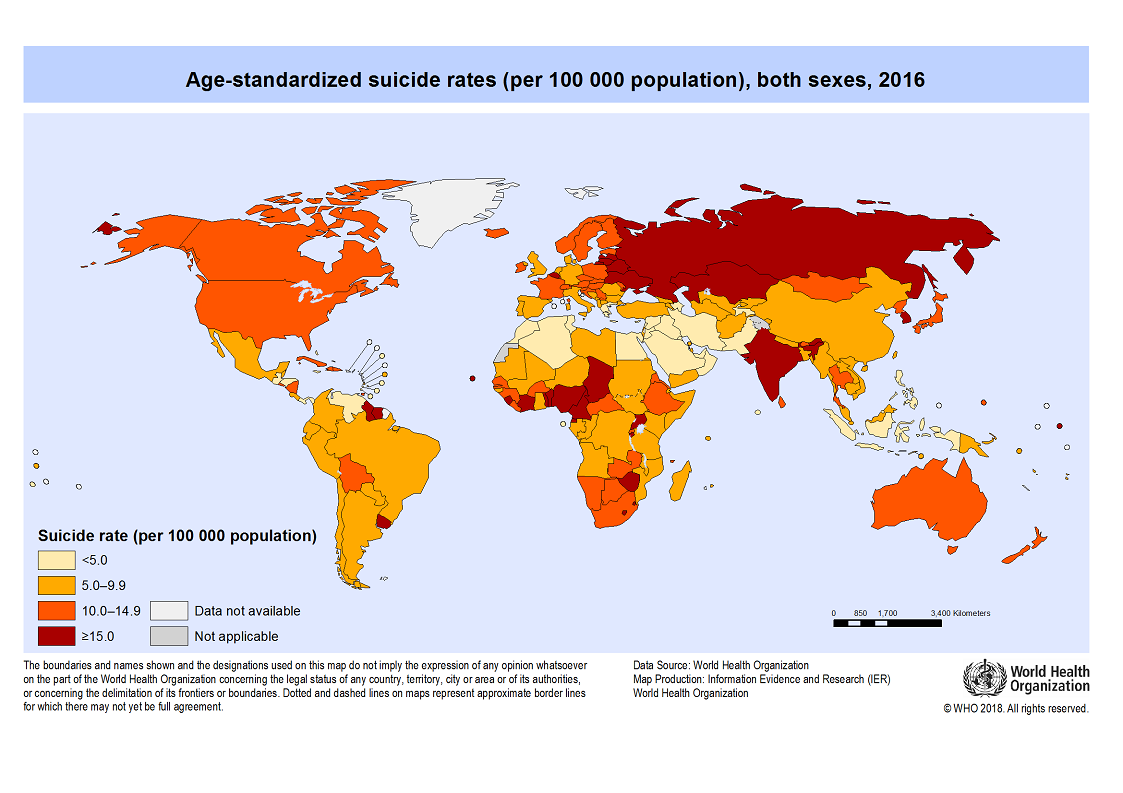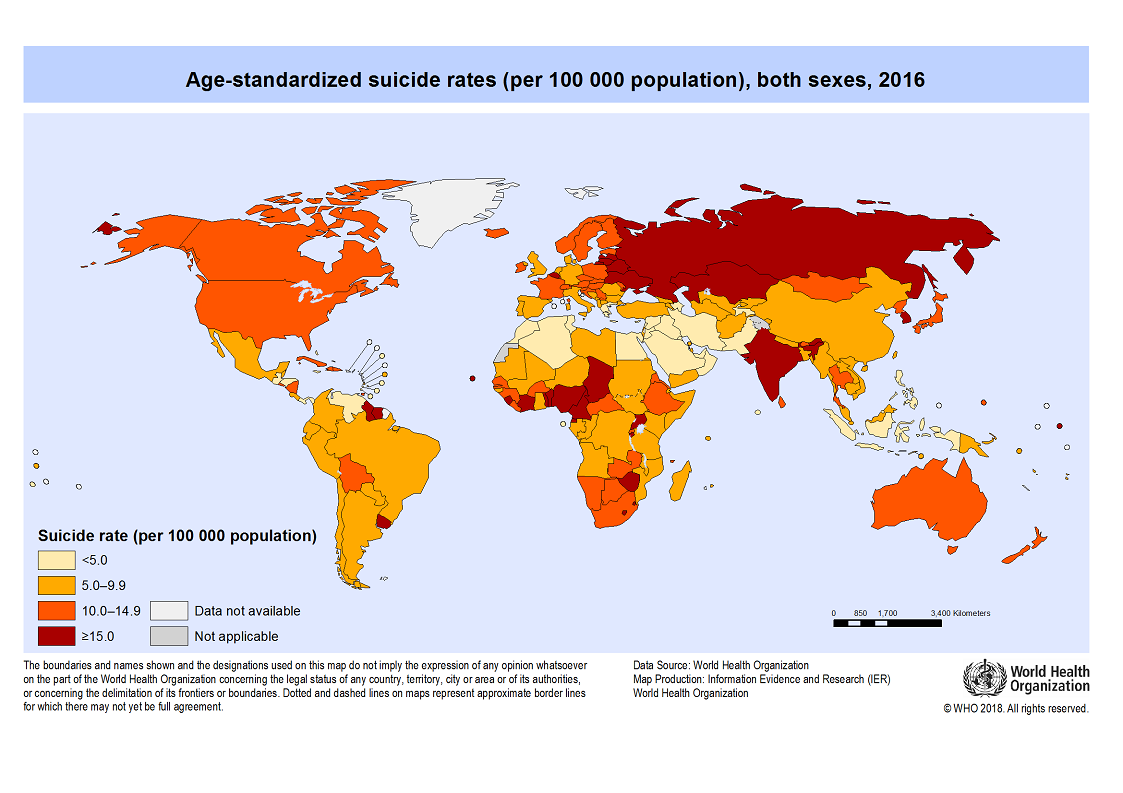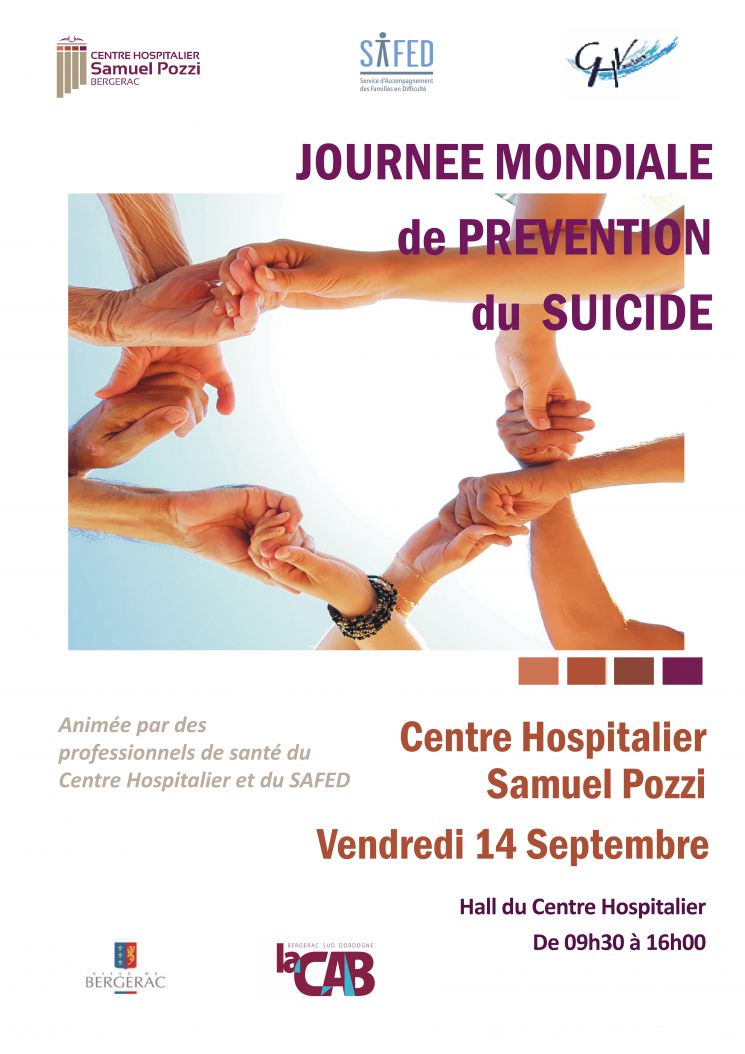Les
croyances religieuses/spirituelles influencent-elles le risque de
suicide chez les enfants ? Oui, à en croire une étude américaine publiée
dans
qui montre que les jeunes vivant dans des
familles où la religion est importante sont moins à risque de pensées
ou de conduites suicidaires (odds ratio 0,61, IC95% : 0,41 -
0,91, P=0,02)
. Dans ces familles de composition
classique, et principalement chrétiennes, avec des antécédents de
dépression majeure, le fait que les parents attachent de l’importance à
la religion était lié à une diminution de 80% du risque d’idéation
suicidaire ou de tentatives de suicide chez les enfants par rapport à
ceux dont les parents n’attachaient pas d’importance à la
religion/spiritualité. Une piste à explorer par les psychiatres, qui
d’habitude, ne s’aventurent pas sur ce terrain, selon les auteurs issus
du New York State Psychiatric Institute et de Columbia University.
,
professeur d’épidémiologie et de psychiatrie (Columbia University
College of Physicians and Surgeons), membre du conseil scientifique de
l’American Foundation for Suicide Prevention, et auteur senior de
l’étude, explique que la « force intérieure » donnée par une religion ou
une spiritualité aiderait à structurer la vie de famille et donnerait
une « protection ».
Aux
Etats-Unis, le suicide est un phénomène en hausse ces dernières années.
Toutes les tranches d’âge sont concernées. Près de 12% des adolescents
dissent avoir eu des pensées suicidaires, et le suicide est la première
cause de mortalité chez les jeunes femmes entre 15 et 19 ans. Et toutes
les pistes pour essayer d’y faire face méritent d’être explorées. C’est
le cas des croyances religieuses, qui ont fait l’objet de plusieurs
études, mais peu se sont intéressées à celles des parents et à leur
influence potentielle sur le risque suicidaire de leurs enfants.
Pour étudier ce lien, les chercheurs se sont fondés sur
une cohorte portant sur trois générations suivies pendant 30 ans et ont
observé des enfants et des adolescents (Génération 3) dont les parents
(Génération 2) étaient potentiellement à risque de dépression majeure en
raison du statut dépressif des grands-parents (Génération 1).
L’étude
observationnelle longitudinale a inclus 214 enfants, âgés de 6 à 18 ans
(12,5 ans en moyenne) issus de 112 familles blanches, originaires de la
région de New Haven dans le Minnesota. Les deux tiers venait de
familles à haut risque dépressif, l’âge des parents était de 39,8 ans
dont 80% était mariés ou remariés.
Environ
85% des enfants ont dit appartenir à une famille de confession
chrétienne : 59% de catholiques et 26% de protestants. Les participants
ont été interrogés sur leur présence aux services religieux et invités à
graduer l’importance qu’occupait la religion dans leur vie. Cet intérêt
pour la religion a été résumé dans l’étude sous le terme de
« religiosité ».
Plus de parents (45%) que d’enfants (25%) ont
rapporté que la religion/spiritualité était très importante pour eux. Et
plus d’enfants (15%) que de parents (4%) ont dit que c’était totalement
sans importance
Quand ils
ont ajusté sur l’âge, le sexe et le statut dépressif familial en termes
de risque, les chercheurs ont trouvé que le fait que la religion soit
importante pour les enfants était associée à un moindre risque
suicidaire chez les jeunes filles (odds ratio [OR] : 0,48; [IC95% : 0,33
– 0,70;
P < 0,002]). Une corrélation non retrouvée chez les garçons (OR : 1,15; [IC95% : 0,74 – 1,80]).
Question de croyance intérieure
Mais
quand les chercheurs ont refait les analyses statistiques en prenant en
compte les enfants (garçons et filles) en y ajoutant cette fois les
croyances religieuses/spirituelles parentales, il s’est avéré que plus
celles-ci étaient fortes, plus le risque de comportements suicidaires
chez les enfants était faibles (OR : 0.61; [IC95% : 0,41 – 0,91;
P < 0,05]).
Les
chercheurs ont, par ailleurs, observé une diminution de 80% du risque
de comportement suicidaire chez les enfants dont les parents
rapportaient une forte « religiosité » comparé aux enfants pour lesquels
les croyances religieuses/spirituelles n’étaient pas importantes.
Dans
la plupart des cas, la corrélation inverse que l’on trouvait avec la
religiosité n’était pas vérifiée si l’on ne prenait en compte que le
fait de fréquenter un office religieux.
C’est
probablement ce qui fait dire à Myrna Weissman : « il y a quelque chose
chez les parents qui ont des croyances ou un engagement fort en dehors
de la famille ou bien d’eux-mêmes qui est aidant et protecteur pour les
enfants ».
La religion en elle-même
n’a, selon elle, que peu d’importance : « Ce n’est le temps que l’on
passe à la synagogue ou à l’église/temple, ni même la religion elle-même
qui fait la différence, ce n’est pas une question de présence à un
office mais de conviction intérieure ».
Des différences filles/garçons
Quand
l’analyse a consisté à stratifier les enfants en fonction de leur sexe,
l‘importance de la religion pour les parents est clairement apparue
corrélée avec un moindre risque d’idées suicidaires et de tentatives de
suicides chez les filles (OR, 0.51; [IC95% : 0,29 – 0,90;
P = 0,02]) mais pas chez les fils (OR : 0,75; [IC95% : 0,47 – 1,19;
P = 0,22]).
Une
différence entre filles et garçons qui constitue « un mystère » pour
Myrna Weissman mais n’est pas une surprise puisqu’elle ajoute :« Si nous
étions les seuls à trouver cela, on pourrait parler de hasard, mais un
certain nombre d’études ont trouvé que les filles sont plus sensibles
aux croyances religieuses de leurs parents ».
Ce n’est pas une question de présence à un office mais de conviction intérieure
Myrna Weissman
Enfin,
quand on s’intéresse simultanément aux croyances des parents et des
enfants, on trouve là-encore un moindre risque quand la religion est
très importante pour les parents (OR : 0,61; [IC95% : 0.39 – 0,96]), et
ce indépendamment des croyances des enfants.
Par
ailleurs, les liens entre la religiosité parentale et le comportement
suicidaire des enfants étaient indépendants de la dépression parentale
et des idées suicidaires parentales – deux risques majeurs de
comportement suicidaire.
Aborder la question de la religion/spiritualité
« Quand
cela semble indiqué, les psychiatres devraient interroger les parents
dont les enfants ont un comportement suicidaire sur leurs croyances
religieuses » propose Myrna Weissman.
« Nous
avons tendance, dans la profession médicale, à nous tenir éloigner de
ce type de considérations, considérées comme personnelles. Mais si vous
pensez que c’est important, alors vous devriez essayer d’en savoir plus,
ça ne devrait pas être tabou » ajoute-t-elle, tout en remarquant que
dans certaines religions, le suicide est considéré comme un péché et que
peut-être certains patients ne voudront pas aborder le sujet.
Un certain nombre d’études ont trouvé que les filles sont plus sensibles aux croyances religieuses de leurs parents
Myrna Weissman
Sentiment de communauté
Dans un commentaire de l’étude pour Medscape Medical News, le pédopsychiatre
David Fassler
(University of Vermont College of Medicine, Burlington) s’est dit en
accord avec cet éclairage, « les cliniciens vont peut-être vouloir
prêter plus attention aux croyances et à l’investissement religieux des
parents au moment de l’évaluation du risque de suicide chez un enfant ou
un adolescent.
Interrogé par Reuters, le
Dr John Walkup,
professeur de psychiatrie (Northwestern University’s Feinberg School of
Medicine et Robert H. Lurie Children’s Hospital, Chicago) n’a pas été
surpris de ces résultats et considère de façon générale que « si les
familles ont un principe d'organisation qui définit qui elles sont et
comment elles vivent, et si elles ont élevé leurs enfants dans ce type
de construction, alors cela constitue une structure qui peut aider à
prévenir le suicide, car cela donne un but à la famille »
[2].
De son côté, le
Dr Emanuel Maidenberg,
professeur de psychiatrie (David Geffen School of Medicine, University
of California, Los Angeles) et directeur de l’UCLA Cognitive Behavioral
Therapy Clinic rappelle qu’il y a une théorie sur le suicide qui suggère
que trois composants conduisent les personnes à se suicider
[2].
« Premièrement, ils se perçoivent comme un fardeau pour les autres ».
Ensuite, « ils ne ressentent aucun sentiment d'appartenance ». Enfin,
« le troisième élément est qu'ils ont appris à ne pas avoir peur de se
faire du mal ». Il est donc possible que l'attitude des parents
vis-à-vis de la religion soit protectrice parce que « cela donne un
sentiment de communauté », a déclaré le Pr Maidenberg. Un concept qui
convient au Pr Walkup : « La religion vous intègre dans une communauté
de personnes partageant les mêmes idées ».
Il est donc possible que l'attitude des parents vis-à-vis de la
religion soit protectrice parce que « cela donne un sentiment de
communauté »
Dr Emanuel Maidenberg
L’étude a été financée en partie par des
bourses de recherche de la Fondation John Templeton et le National
Institute of Mental Health.
Certains co-auteurs ont rapporté
des relations avec le National Institute of Mental Health, la Foundation
Sackler, la Fondation Templeton, et MultiHealth Systems.
|
https://francais.medscape.com/voirarticle/3604362#vp_1
Réference etude citée
August 8, 2018
Association of Parent and Offspring Religiosity With Offspring Suicide Ideation and Attempts
Connie Svob, PhD1,2; Priya J. Wickramaratne, PhD1,2; Linda Reich, MS2;
Ruixin Zhao, MS1; Ardesheer Talati, PhD1,2; Marc J. Gameroff, PhD1,2; Rehan Saeed, MD1; Myrna M. Weissman, PhD1,2
JAMA Psychiatry. Published online August 8, 2018. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.2060