Alice, 25 ans : « J’ai longtemps eu honte de mes tentatives de suicide. Mais j’ai toute une vie pour me reconstruire » Le Monde (site web)
campus, mardi 12 janvier 2021
Léa Iribarnegaray
Entre ses 20 ans et ses 23 ans, Alice, alors étudiante, a commis quatre tentatives de suicide. Burn-out, dépression sévère… une descente aux enfers qu’elle raconte, aujourd’hui épanouie. Alice a 25 ans et « un CV aux allures de tableau impressionniste ». Discrète mais déterminée, elle se fait le porte-voix de ces jeunes qui, après avoir voulu mourir, sont désormais heureux de vivre. « C’est fou de me dire qu’il y a deux ans, je faisais ma quatrième tentative de suicide, observe-t-elle. J’ai longtemps considéré cette période comme un truc honteux, cauchemardesque. Aujourd’hui, je me dis que j’ai eu une maladie ponctuelle – une dépression – pas quelque chose que je vais traîner ma vie entière. En plus, je l’ai eue jeune, alors j’ai toute une vie pour me reconstruire ».
Sans banaliser ni héroïser, le journaliste a une responsabilité dans le récit d’un passage à l’acte. Des dizaines d’études ont démontré l’existence d’un phénomène de suicide par imitation : c’est ce qu’on appelle « l’effet Werther », en référence au roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, dans lequel le protagoniste met fin à ses jours, en proie à un amour impossible. Suite à la publication de l’ouvrage, en 1774, les spécialistes avaient constaté une multiplication des suicides de jeunes hommes.
Mais ces mêmes mécanismes peuvent aussi, à l’inverse, promouvoir la prévention. C’est « l’effet Papageno » - d’après le personnage de l’opéra de Mozart, La flûte enchantée. Alors que Papageno envisage de se pendre, imaginant avoir perdu sa promise, trois génies l’invitent à réfléchir à une autre voie. L’évocation du suicide se révèle alors protectrice : il s’agit de rappeler que grâce à l’entraide et aux soins, une personne en grande souffrance peut s’en sortir.
Juste après le bac, Alice choisit d’étudier en Ecosse, mais prend part à « la grande culture de la fête et du “binge drinking” »
Avant de s’enfoncer « plus bas que terre », Alice était, selon sa mère, « une jeune fille enthousiaste, attachée à faire plaisir aux autres ». Pendant ses années de lycée, elle avait préparé les concours pour entrer à Sciences Po, passé son permis, travaillé l’été en tant que monitrice de voile, participé à une régate entre établissements… Juste après le bac, celle qui a grandi dans une famille d’expatriés (un père cadre et une mère formatrice) choisit d’étudier à l’étranger. Direction l’Ecosse, pour une licence bidisciplinaire, en histoire et littérature anglaise, à l’université de Glasgow.
« J’avais vécu aux Etats-Unis, au Brésil, j’avais l’habitude de m’adapter à différentes cultures, raconte-elle. Mais en arrivant, ça a été un choc auquel je ne m’attendais pas. » Pour s’intégrer à cette vie nouvelle d’étudiante, la jeune femme prend part à « la grande culture de la fête et du binge drinking » : « Je ne mangeais pas bien, je ne dormais pas bien, mes études passaient au second plan. »
Elle réalise alors que depuis le lycée, tout s’est empilé comme un mille-feuille trop lourd. « J’ai toujours été très bosseuse, précise Alice. Je pensais que si je n’avais pas de bonnes notes, je n’avais pas de valeur. » En deuxième année à l’université, elle commence à développer des crises d’angoisse, ainsi qu’une trichotillomanie (un trouble psychologique qui fait qu’on s’arrache les cheveux de manière compulsive). Elle perd la capacité de lire, d’écrire, de se concentrer – syndrome connu de burn-out. « Je ne savais pas ce qui se passait, souffle-t-elle. Je me suis dit que c’était juste une phase. J’en ai parlé à personne et je me suis isolée de plus en plus. »
« Une souffrance qui va croissant » Les idées suicidaires ne surviennent jamais du jour au lendemain : « C’est un processus lié à une souffrance qui va croissant, explique Charles-Edouard Notredame, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent et cofondateur du programme de prévention Papageno. Plus la souffrance avance, moins je perçois de solutions à sa résolution. Le suicide m’apparaît progressivement comme la seule option pour alléger cette souffrance. »
M. Notredame décrit « une certaine progressivité » – depuis la simple idée de la mort, à l’élaboration d’un scénario et d’une manière de faire, jusqu’au passage à l’acte. Entrer dans cet engrenage implique des « biais cognitifs » : comme si l’on portait des lunettes noires, on perçoit le monde tout en noir. Pour changer de lunettes, il faut réussir à en parler, consulter un professionnel de santé, soigner les troubles psychiques. « On peut intervenir à toutes les étapes, rappelle le chef de clinique au CHU de Lille. Dès qu’on apaise la souffrance, les solutions réapparaissent. »
« Je voyais bien qu’elle portait une tristesse, que physiquement ça n’allait pas », se souvient sa mère
Le jour où Alice se décide à prendre rendez-vous avec un psychologue de son université écossaise, la liste d’attente est longue comme le bras. Ses parents l’appellent chaque semaine sur Skype : « Je voyais bien qu’elle portait une tristesse, que physiquement ça n’allait pas, se souvient Agnès, sa mère [le prénom a été changé]. Mais en pleine période d’examens, d’une certaine façon il était normal qu’elle soit stressée. » Inquiète, Agnès lui rend visite à la Toussaint et découvre sa fille « dans un piteux état ». Après ses partiels, Alice accepte de prendre le premier vol pour la France.
S’ensuit un long parcours contre un mal invisible. De généralistes en psychologues et en psychiatres. « Mes parents faisaient de leur mieux mais ils n’avaient pas les bonnes infos pour me diriger, relate Alice. Mon état empirait… » Un psychiatre finit par diagnostiquer un burn-out et une dépression sévère. La jeune femme adopte « un traitement très lourd » et dort « vingt heures par jour ». Elle se rappelle : « On perd la capacité de réfléchir, on n’est qu’une version légume de soi-même. »
« L’impression d’une déchirure à l’intérieur de moi » A 20 ans, Alice fait sa première tentative de suicide. Une crise d’angoisse surgit alors que ses parents ne sont pas là : « Ce n’était pas planifié. Pendant mes crises, j’avais très, très mal. L’impression d’une déchirure à l’intérieur de moi. Je me donnais des coups de poing. Il fallait faire taire ces voix qui me disaient que j’étais un poids pour les autres, que je méritais de ne pas vivre… La seule manière de mettre fin à la souffrance, c’est de s’attaquer à soi-même, puisque c’est de là qu’elle venait. » Alice avale une grande quantité de médicaments et s’effondre dans sa chambre.
« Je me comparais beaucoup à mes amis, qui avançaient dans leur vie »
Hospitalisée, la jeune femme retrouve une routine qu’elle avait torpillée. On lui impose un réveil à 8 heures et des séances de sport quotidiennes. Au bout de trois mois, Alice se sent guérie. Elle veut reprendre une vie normale : diminuer son traitement, avoir une vie sociale, donner des cours d’anglais. Mais le monde ne s’est pas arrêté de tourner : « Mes amis avançaient dans leur vie, faisaient des études… choses que j’étais incapable de faire. Je me comparais beaucoup à eux. »
Alors les symptômes reviennent, d’autant plus forts. Nouvelle crise d’angoisse seule à la maison et encore le besoin de « se libérer ». Dans un état second, par ailleurs sédatée par les médicaments, Alice prend la voiture de ses parents avec l’idée folle de recouvrer son souffle en Bretagne. Elle frôle l’accident. Seconde hospitalisation et souvenirs brumeux.
Maladie floue à durée indéterminée Cette fois-ci, Alice prend le temps de la convalescence. « On était dépassé, souligne sa mère. Quand on a le bras cassé, on sait que ça va se résorber après tant de semaines. Mais comment voulez-vous soigner l’âme cassée de quelqu’un ? » Maladie floue à durée indéterminée, la dépression d’Alice « désorganise toute la vie familiale » : « Sur le qui-vive, vous redoutez à tout moment que le téléphone sonne. Vous lâchez tout et partez au secours de votre enfant, en espérant ne pas arriver trop tard, décrit Agnès, maman de deux autres filles. Je m’étais préparée à accepter de la perdre. A la troisième tentative de suicide, vous savez que la suivante risque d’être la dernière. »
Alice reprend des études : une formation d’un an en graphisme. Lorsqu’elle apprend le cancer de sa mère, Alice file en douce à une soirée et boit jusqu’au coma. Contrairement aux tentatives précédentes, elle se réveille « très énervée » face aux pompiers : « Je n’en pouvais plus de cette bataille qui commençait à durer. J’avais fait un choix, on m’empêchait de le faire et moi j’empêchais les autres d’avancer. »
« Comprendre que j’étais peut-être surdouée m’a aidée à m’accepter »
La troisième hospitalisation est plus longue, mais l’étudiante poursuit ses cours à distance. Elle termine avec les félicitations du jury et réussit un travail sur elle-même. « J’ai confronté les fantômes qui m’empêchaient d’avancer » – elle évoque un viol qu’elle a subi à 18 ans, et longtemps nié. On la diagnostique comme personne hypersensible, au quotient émotionnel élevé. « Jusque-là, je pensais être folle, incapable de m’intégrer. Comprendre que j’étais peut-être surdouée m’a aidée à m’accepter. »
Parce que sa maladie fait peur, que ses crises peuvent paraître impressionnantes, Alice n’ose jamais en parler. En dehors de ses parents et de l’ami qui l’a retrouvée inanimée en soirée, personne ne sait. « J’avais toujours honte d’aller mal, de replonger. J’avais cette culpabilité de ne pas réussir à aller mieux toute seule, d’être faible, égoïste… »
Un pêcheur la découvre sur la plage En sortant pour la troisième fois de l’hôpital, Alice vit un « gros chagrin d’amour » et se dit que personne ne pourra l’aimer. « J’ai tout planifié, c’est la seule fois où j’avais vraiment en tête de mettre fin à mes jours ». Elle fait un plein d’alcool et de médicaments qu’elle prévoit d’ingérer face à la mer, en Bretagne, avant d’aller se noyer – « j’ai perdu connaissance avant de pouvoir me jeter à l’eau ». Au petit matin, un pêcheur la découvre sur la plage et appelle les secours.
« En hôpital psychiatrique, on voit des personnes qui ne s’en sortent jamais et reviennent indéfiniment »
Pendant une dernière hospitalisation « plus violente », environ trois ans après la première, Alice côtoie des patients qui lui permettent de relativiser. « En hôpital psychiatrique, on voit des personnes qui ne s’en sortent jamais et reviennent indéfiniment. Ce cycle infernal, c’était mon futur. » C’est à ce moment-là qu’elle décide d’aller mieux, d’abord pour ses proches, puis pour elle. Petit à petit, Alice remonte la pente, sort de son brouillard, reprend « l’espoir qu’il existe un après ». « J’ai été plus gentille et clémente avec moi-même », explique-t-elle.
Alice a l’envie de devenir professeure d’anglais. Elle commence une formation d’un an, se découvrant à la fois un talent et un horizon. Son hypersensibilité se transforme en atout : empathique et patiente, la jeune femme peut devenir une excellente enseignante. Plus sereine, elle reprend une licence d’anglais à l’université. Là voilà aussi bénévole pour l’association Nightline, un service d’écoute nocturne destiné aux étudiants. Très au fait des questions de santé mentale, Alice prête son oreille attentive aux jeunes qui en ont besoin.
Etre utile en aidant les autres « Si mon histoire a été si longue, si tortueuse, c’est parce que je n’avais pas d’infos. Je veux empêcher les autres de tomber aussi bas que je suis tombée. » Après un stage, Nightline lui propose un contrat en tant que chargée de communication. Elle a enfin trouvé sa place. « Dans le futur, je pourrai toujours devenir prof d’anglais, dit-elle. Pour l’instant, c’est là que je suis la plus utile. »
« J’ai été obligée de faire un travail sur moi que certains ne prennent jamais le temps de faire au cours d’une vie »
Passée la honte, et même si elle n’a pas le diplôme bac + 5 de ses amis, la rescapée se dit qu’elle a traversé « l’école de la vie ». « J’ai été obligée de faire un travail sur moi que certains ne prennent jamais le temps de faire au cours d’une vie, souligne-t-elle. En licence d’anglais, je savais pourquoi j’étais là. » Si cela semble miraculeux, bien d’autres jeunes réussissent à s’extraire du mal qui les ronge.
« Dire qu’elle a souffert est un euphémisme, articule sa mère. Je suis admirative de la façon dont elle a rebondi. Elle a trouvé un sens à sa vie. » « Une maladie psy peut arriver à tout le monde, à tout moment. Il faut en parler, s’informer, consulter… », martèle Alice, encore sous traitement, mais épanouie. « Très contente d’être ici » – en vie –, la jeune femme n’a plus d’animosité. Un « dernier truc » la titille : retrouver ce pêcheur, le long d’une côte bretonne, pour lui dire merci.
Cet article est paru dans Le Monde (site web)


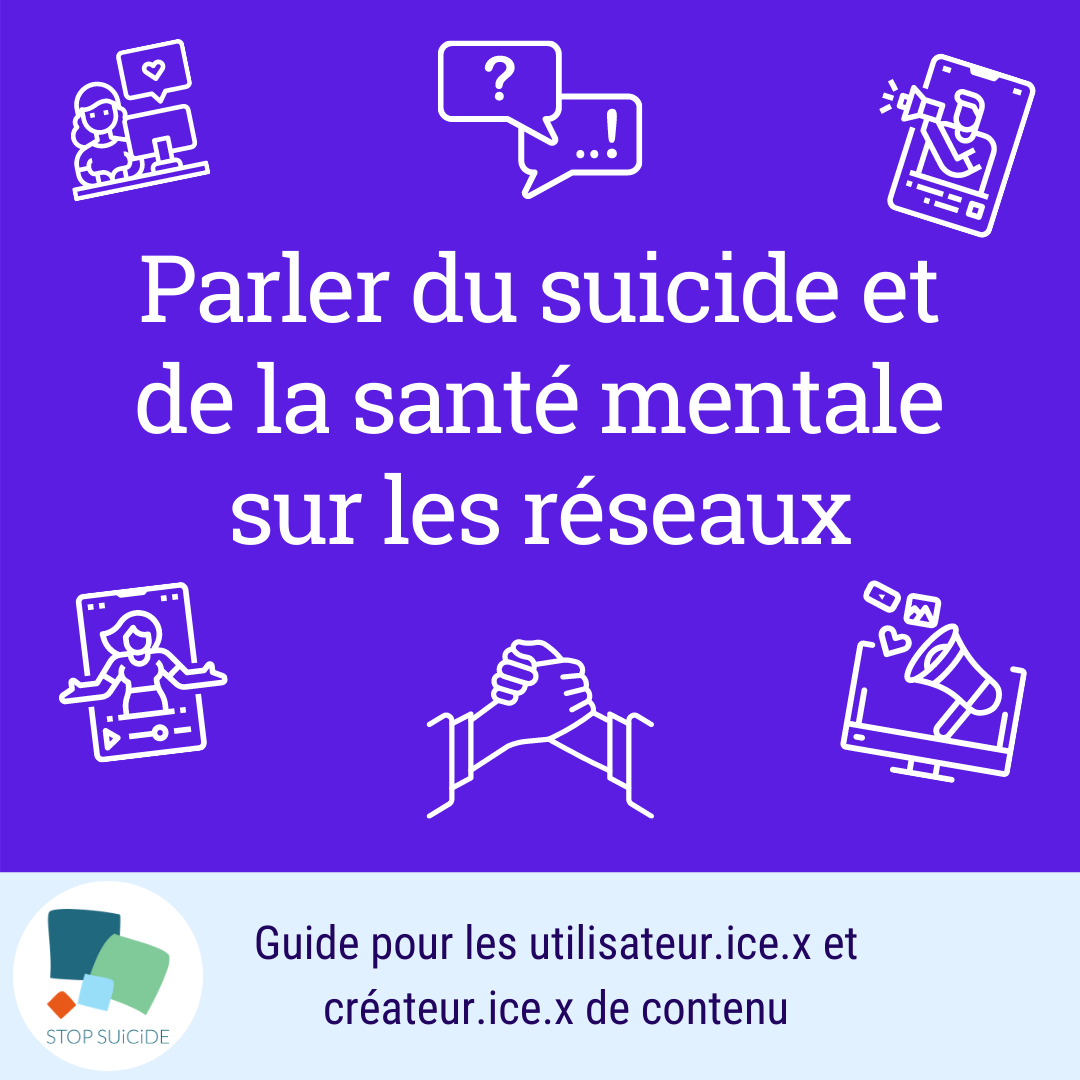

 For
further information: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter
notre site internet www.en-tete.ca, ou encore à communiquer avec Lise
Villeneuve, au 514-895-2106, lise.mesdixdoigts@gmail.com, ou encore Jane
Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la
violence et le traumatisme, au 1-519-852-4946, jane.hawkes@journalismforum.ca
For
further information: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter
notre site internet www.en-tete.ca, ou encore à communiquer avec Lise
Villeneuve, au 514-895-2106, lise.mesdixdoigts@gmail.com, ou encore Jane
Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la
violence et le traumatisme, au 1-519-852-4946, jane.hawkes@journalismforum.ca