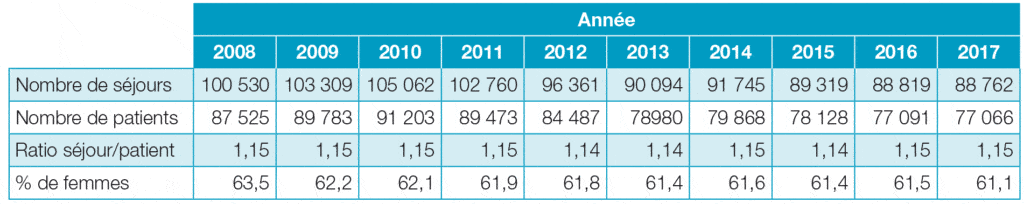Professionnels Sécurité du patient S’engager dans un dispositif Flash sécurité du patient
Flash sécurité patient - Suicide Mieux vaut prévenir que mourir
Date de validation : avril 2022
Documents : 2
Flash sécurité patient - Mis en ligne le 08 sept. 2022 has-sante.fr
La France fait partie des pays européens les plus touchés par le suicide. En effet, en 2016, on comptait 9 300 décès par suicide en France métropolitaine. A ce chiffre s’ajoutent environ 200 000 tentatives de suicide par an donnant lieu à un contact avec le système de soins. Le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans et la deuxième chez les 15-24 ans, après les accidents de la voie publique.
Objectifs
En partageant le retour d’expérience des professionnels confrontés à ces évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS), ce flash permet : d’alerter les professionnels de santé et les équipes de soin de la survenue d’EIGS qui auraient été évités par une évaluation du risque suicidaire ;
de sensibiliser les professionnels de santé à la prévention des suicides de patients ;
de contribuer à la diminution des risques d’erreurs liées à la prise en charge des patients suicidaires ;
de renforcer l’information et la formation des personnels de soin sur les bonnes pratiques d’évaluation et de prise en charge des patients suicidaires.
Pour que cela ne se reproduise pas :
L’analyse des EIGS fait apparaitre plusieurs causes profondes principales à ces évènements : le défaut de sécurisation des locaux, la surcharge de travail, le manque de formation en psychiatrie et santé mentale des professionnels de santé, le défaut d’organisation du service et le défaut de communication entre les équipes.
Pour aider à prévenir et à prendre en charge les patients ayant un risque suicidaire : Penser à repérer systématiquement le risque suicidaire ;
Penser à repérer les troubles de l’humeur ;
Penser à informer sur les dispositifs de soutien existants (exemples : VigilanS, SOS Amitié France[1]…) ;
Ne pas négliger la postvention[2]. .
[1] 31 14
Numéro SOS Amitié France : 01 40 09 15 22.
[2] La postvention comprend les actions développées par, avec ou pour les survivants d’un suicide, dans le but de faciliter leur rétablissement, et pour prévenir les issues négatives, incluant les tentatives de suicide – www.infosuicide.org/guide/postvention/
Documents Flash sécurité patient - " Suicide Mieux vaut prévenir que mourir " 
Documents complémentaires Note de cadrage Flash Sécurité Patient - Février 2021 
Service Évaluation et Outils pour la Qualité et la Sécurité des Soins (EvOQSS)
ARTICLES SUR LE SUJET
Suicides en structures médico-sociales : agir avec des mesures préventives
Publié le 28/09/2022 • Par Laure Martin •
Ma Gazette
La Haute Autorité de santé (HAS) a publié en septembre des préconisations afin de réduire le nombre de suicides et tentatives de suicides au sein des établissements médico-sociaux et sanitaires. Des mesures préventives sont à instaurer.
Le processus suicidaire est parfois considéré comme énigmatique, imprévisible, inéluctable au point de ne pas être inscrit dans la prévention, alors même qu’il est classé de façon universelle dans les morts évitables ou du moins partiellement.
Par ailleurs, le suicide occupe une position particulière parmi les Événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) pouvant survenir lors de la prise en charge d’un patient car il génère souvent un sentiment d’échec et de culpabilité chez les professionnels de santé et incite parfois à une remise en question professionnelle et institutionnelle.
Face à ces constats et après l’analyse de 795 cas déclarés de suicides et tentatives de suicide de patients dans le cadre du dispositif de déclaration des EIGS (mars 2017-juin 2021), la HAS en a identifié les circonstances et les causes, à la fois générales et propres à certaines catégories de la population et partage des recommandations, notamment pour les personnes âgées.
Des caractéristiques propres aux personnes âgées
D’après les données de l’Observatoire national des personnes âgées, un suicide sur trois concerne une personne âgée, majoritairement des personnes de 75 ans ou plus.
« Dans cette tranche d’âge, la mort par suicide a plus de chances d’être imputée, à tort, à une cause naturelle ou accidentelle (erreurs dans la prise de traitement, chutes par exemple) », met-il en garde. Des caractéristiques spécifiques aux personnes d’âge avancé ont été mises en évidence telles que des crises suicidaires plus insidieuses que chez les sujets plus jeunes ; un effet masquant des affections somatiques qui prennent le devant de la scène conduisant à moins explorer d’autres causes au mal-être ; une détermination importante ; des tentatives plus planifiées ; une moindre résistance physique ; et un recours à des moyens plus létaux.
En plus des facteurs de risque de suicide communs aux autres âges de la vie, d’autres sont spécifiques aux personnes âgées tels que les expériences de deuil, de perte, de séparation et de solitude ou encore les symptômes physiques continus tels que les maladies en phase terminale, les maladies physiques aiguës et les douleurs chroniques.
Des périodes à risque ont également été identifiées, dont le mois qui précède l’entrée dans un Ehpad et le mois suivant l’admission.
Des mesures à mettre en place
Pour agir, la HAS préconise d’abord de travailler sur les idées reçues, qui peuvent constituer un frein à la mise en place de politique préventives. Parmi elles, le fait de penser que les personnes parlant du suicide ne vont pas passer à l’acte et inversement, que le suicide est un acte de liberté à respecter, notamment pour les sujets d’âge avancé ou encore que de poser des questions sur le suicide peut l’inciter.
Par ailleurs, elle recommande de mettre en place des mesures concernant la sécurisation de l’environnement (locaux et matériel). Certes la limitation de l’accès aux moyens ne réduit pas la souffrance du patient mais elle lui indique qu’il est dans un lieu où la protection est une valeur concrète. D’autant plus que la crise suicidaire est souvent temporaire. A titre d’exemple, les mesures de prévention de la pendaison et de la strangulation – premier moyen utilisé en population générale – doivent porter sur les points de fixation (porte-manteaux, potences, poignées de porte et de fenêtres, entrées de serrure, montants de lit, robinets) ou les objets pouvant servir de lien (vêtement, ceinture, lacets, drap, cordon électrique, cordon de sonnette, tuyau de douche).
Il faut aussi envisager la prévention de la chute d’un lieu élevé, deuxième moyen utilisé, en limitant l’accès aux terrasses, aux escaliers de secours, aux balcons ou encore aux fenêtres qui peuvent être ouvertes ou brisées. De fait, la conception d’unités de soins situées en rez-de-chaussée pour les patients suicidaires ou suicidants est recommandée.
Autre recommandation : élaborer un plan personnalisé de sécurité, tenant compte de la mise en sécurité de la personne quant à l’accès aux moyens de suicide et visant à préparer le parcours du patient dans les heures et jours qui viennent. Cette anticipation porte sur les souffrances que pourrait éprouver le patient et vise à développer les stratégies pour faire face aux difficultés et à l’aggravation de la crise suicidaire.
Enfin, un point d’attention doit être porté sur l’organisation des soins et du service avec notamment l’évaluation du risque suicidaire ou la surcharge de travail ou encore l’isolement du patient.
Références Pour lire l'intégralité du rapport : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/rapport_les_sucides_et_tentatives_de_suicide_de_patients_juillet_2022.pdf
***
Analyser les suicides et tentatives de suicides en milieu de soins
A partir de l’analyse des 795 cas de suicides et tentatives de suicides déclarés dans le cadre du dispositif national de déclaration des événements indésirables graves associés aux soins entre mars 2017 et juin 2021, la HAS publie aujourd’hui :
- le rapport d’analyse des circonstances et des causes de ces 795 évènements assorti d’enseignements et préconisations aux établissements en vue de réduire leur survenue ;
- un nouveau « Flash sécurité patient », illustré par 4 cas pour sensibiliser les professionnels de santé à la gestion des risques de suicides et tentatives de suicide.
Les suicides et tentatives de suicide occupent par leur nature une position particulière parmi les événements indésirables pouvant survenir lors de la prise en charge d’un patient en établissement de santé ou lors de l’accompagnement d’une personne en structure sociale ou médico-sociale. Par cet acte, la personne se met en effet en danger intentionnellement en vue de mettre fin à une souffrance insoutenable.
Ces événements génèrent souvent un sentiment d’échec et de culpabilité chez les professionnels. Tous les secteurs délivrant des soins sont concernés par la survenue de suicides et tentatives de suicides : les établissements de santé, les institutions médico-sociales et la ville. Aucun secteur n’échappe à ce risque, même si les services de psychiatrie sont les premiers déclarants de suicides et tentatives de suicide.
La nature intentionnelle du geste conduit souvent à considérer la prévention du risque de suicide comme quasi-impossible. Pourtant le suicide est classé de façon universelle dans les morts évitables ou, tout du moins, partiellement évitables. Même si les meilleurs résultats obtenus par les programmes de prévention ne permettront jamais d’éviter tous les suicides, il est établi que la mise en œuvre d’un programme (ou projet) d’établissement, de moyens et de formations et une meilleure connaissance des contextes de survenue des suicides permettent de prévenir ces événements.
Le suicide ou tentative de suicide, un événement sentinelle
Le suicide ou la tentative de suicide d’un patient doit être considéré comme un événement sentinelle[1]. A la fois grave et fréquent au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux, il doit, lorsqu’il survient, faire l’objet d’une analyse approfondie par les équipes.
Avec l’analyse des 795 cas qui lui ont été déclarés, la HAS a poursuivi quatre objectifs :
- identifier les circonstances et les causes de ces événements ;
- en tirer des enseignements ;
- proposer des préconisations afin de réduire leur survenue ;
- initier une communication sur ce sujet sensible, notamment par l’illustration de situations concrètes dans le Flash Sécurité Patient.
Tout ceci afin de stimuler une réflexion des professionnels et de l’ensemble des personnels des établissements et structures.
Des préconisations à plusieurs niveaux pour réduire le nombre de suicides et tentatives de suicides
Les trois causes profondes récurrentes identifiées par les équipes dans les déclarations de cas de suicides et tentatives de suicide sont le manque de sécurisation des locaux, l’absence d’évaluation du risque suicidaire et les défauts organisationnels.
Pour y répondre, la HAS rappelle les préconisations qui s’appliquent à tous :
- Définir les objectifs de prévention du suicide au sein de l’établissement (projet ou programme d’établissement).
- Sécuriser l’environnement en limitant notamment l’accès aux moyens possibles de suicide comme :
- les points de fixations et liens pour la pendaison ou la strangulation,
- l’accès aux terrasses, escaliers et fenêtres,
- les sacs plastiques et sacs poubelles pouvant servir d’objet de suffocation,
- les médicaments, objets coupants ou en verre cassable, briquets et sèche-cheveux.
- Évaluer le risque de suicide du patient sur la base de facteurs multidimensionnels comme les antécédents personnels (anciennes tentatives de suicides, addiction en phase de sevrage, dépression, troubles de la personnalité…) ou la survenue d’événements négatifs (perte, conflits, problèmes financiers, dates anniversaires traumatiques, annonce d’un diagnostic ou de soins lourds…).
- Évaluer la situation clinique du patient.
- Construire un plan personnalisé de sécurité quant à l’accès aux moyens de suicide et au parcours du patient dans l’immédiat et dans les jours à venir.
- Savoir gérer l’événement quand il survient (postvention).
- Gérer la sortie d’hospitalisation d’un patient qui a fait une tentative de suicide avec par exemple le dispositif VigilanS.
- Penser aux secondes victimes, les soignants, en les formant, les informant, les accompagnant.
- Améliorer la culture sécurité, notamment par l’utilisation du guide d’évaluation du risque de suicide ou la déclaration des cas.
- Rappeler les droits des personnes malades et en fin de vie.
Ces préconisations sont déclinées par secteur d’activité de façon plus spécifique : établissements de santé mentale (avec des préconisations particulières pour les soins sans consentement et le recours à la chambre d’isolement), établissements Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et Soins de suite et de réadaptation (SSR), établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD).
En synthèse de ces préconisations, 4 messages-clés sont diffusés via un Flash Sécurité Patient consacré à cette thématique :
- Penser à repérer systématiquement le risque suicidaire;
- Penser à repérer les troubles de l’humeur;
- Penser à informer sur les dispositifs de soutien existants (exemples : VigilanS, SOS Amitié France …);
- Ne pas négliger la postvention (la gestion de l’événement quand il survient).
Retrouvez sur le site internet de la HAS, l’intégralité du rapport et le « Flash sécurité patient » relatifs au suicide.
[1] Guide pédagogique de l’OMS pour la sécurité des patients – traduction HAS
Acces au rapport https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/rapport_les_sucides_et_tentatives_de_suicide_de_patients_juillet_2022.pdf