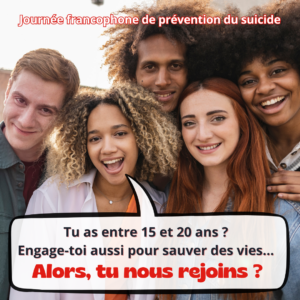Une
solution législative pour la prévention du suicide chez les étudiants :
plaider en faveur du consentement libre et éclairé en réponse aux
préoccupations liées au bien-être des étudiants
d'apres article https://www.hepi.ac.uk/* 10 février 2025 Par Emma Roberts
Rédigé par le Dr Emma Roberts, directrice du département de droit à l'Université de Salford .
La
perte d’un étudiant par suicide est une tragédie profonde et
déchirante, qui laisse les familles et les proches dévastés et révèle
des lacunes critiques dans les systèmes de soutien au sein de
l’enseignement supérieur. Chaque décès est non seulement une tragédie
personnelle, mais aussi un échec systémique, soulignant le besoin urgent
pour les établissements d’enseignement supérieur de renforcer leurs
cadres de protection.
Des données gouvernementales récentes ont révélé que 5,7 % des étudiants locaux ont signalé un problème de santé mentale à leur université en 2021/22, soit une augmentation significative par rapport à moins de 1 % en 2010/11
. Malgré cette prise de conscience croissante des problèmes de santé
mentale, le secteur de l'enseignement supérieur est aux prises avec la
persistance alarmante des suicides d'étudiants.
L’Office for National Statistics (ONS) a fait état d’ un
taux de 3,0 décès pour 100 000 étudiants en Angleterre et au Pays de Galles au cours de l’année universitaire se terminant en 2020, ce qui équivaut à 64 vies perdues.
Derrière chaque statistique se cache une famille en deuil, des
questions sans réponse et la possibilité troublante que davantage aurait
pu être fait. Ces statistiques obligent les universités à affronter des
vérités dérangeantes sur leur capacité à soutenir les étudiants
vulnérables.
Le
temps des solutions fragmentaires est révolu. Pour faire face à cette
crise, des réformes audacieuses et systémiques sont nécessaires. L’une
de ces réformes – l’introduction d’un système de consentement facultatif
pour les contacts avec les services sociaux – pourrait transformer la
façon dont les universités répondent aux étudiants en crise.
Un modèle de consentement par opt-outÀ
l’heure actuelle, les universités ont généralement recours à des
systèmes de consentement, dans lesquels les étudiants sont invités à
désigner une personne à contacter en cas d’urgence. Ce système est connu
sous le nom de modèle de consentement de Bristol. Lorsque ce système
existe, il n’est pas toujours utilisé lorsque les étudiants sont
confrontés à de graves problèmes de santé mentale. La réticence provient
souvent de la crainte de ne pas respecter les lois sur la
confidentialité et de la peur des répercussions juridiques. Cette
hésitation peut entraîner des retards critiques dans l’implication du
réseau de soutien d’un étudiant au moment où son bien-être peut être le
plus menacé, ce qui empêche les universités de fournir des interventions
rapides et vitales. En outre, les données suggèrent que de nombreux
étudiants, en particulier ceux qui souffrent de problèmes de santé
mentale, ne font pas appel à ces systèmes, ce qui empêche les
institutions d’avertir leurs proches lorsque de graves problèmes
surviennent.
Toutes les universités ne disposent pas d’un tel système. Et
certaines universités, bien qu’elles puissent avoir un processus de «
personne désignée », ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire
pour activer de manière appropriée le mécanisme de mise en relation avec
la personne à contacter en cas d’urgence lorsque cela est le plus
nécessaire.
Un modèle de consentement par option inverserait cette règle
par défaut, en inscrivant automatiquement les étudiants dans un système
où une personne de confiance – comme un parent, un tuteur ou un contact
choisi – peut être informée si leur bien-être soulève de graves
inquiétudes. Inspirée du système de consentement par option de don
d’organes en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles, cette approche
donnerait la priorité à la protection sans porter atteinte à l’autonomie
des étudiants.
La confidentialité doit être équilibrée avec la nécessité de
protéger la vie. Un modèle de consentement par option offre précisément
cet équilibre, en créant un filet de sécurité proactif qui soutient les
étudiants tout en respectant leur indépendance.
Disposition législativePour
qu'un tel système soit efficace, il doit être soutenu par une
législation solide et des garanties pratiques. Les principales mesures à
prendre sont les suivantes :
- Communication complète
: les universités doivent expliquer clairement le but et le
fonctionnement du système de retrait lors de l’intégration des
étudiants, en veillant à ce que les individus soient pleinement informés
de leurs droits et de leurs options.
- Déclencheurs définis
: les critères permettant de solliciter un contact avec l'enfant
doivent être transparents et appliqués de manière cohérente. Il peut
s'agir d'absences prolongées, de comportements inquiétants ou de menaces
explicites de préjudice.
- Examens réguliers
: les étudiants devraient avoir la possibilité de mettre à jour ou de
retirer leur consentement tout au long de leurs études, garantissant que
le système reste flexible et respectueux de l’évolution des
circonstances personnelles.
- Protection de la vie privée
: les établissements doivent partager uniquement les informations
essentielles avec le contact désigné, garantissant ainsi la préservation
de la confidentialité plus large de l'étudiant.
- Formation du personnel
: le personnel universitaire, y compris le personnel des services
académiques et professionnels, doit recevoir une formation régulière sur
la reconnaissance des signes de crise de santé mentale, la gestion des
limites de confidentialité et le respect des exigences du système de
retrait. Cette formation contribuerait à garantir que les interventions
sont opportunes, appropriées et conformes aux normes juridiques et
institutionnelles.
- Rapports et audits
: les universités devraient mettre en place des mécanismes de rapport
et d’audit solides pour évaluer l’efficacité du système de refus. Cela
devrait inclure la tenue de registres des cas où le contact avec les
services sociaux a été invoqué, le suivi des résultats et la réalisation
d’audits périodiques pour identifier les lacunes ou les domaines à
améliorer. Des rapports transparents permettraient non seulement
d’améliorer la responsabilisation, mais aussi de favoriser la confiance
entre les parties prenantes.
Les leçons du modèle du don d’organesLe
système de refus du don d’organes mis en place au Pays de Galles et en
Angleterre démontre l’efficacité d’une refonte du consentement pour
favoriser l’intérêt général. Après sa mise en œuvre, la confiance du
public a été maintenue et le nombre de donneurs d’organes enregistrés a augmenté
. Une approche similaire dans l’enseignement supérieur pourrait établir
une base de référence proactive pour la protection sans contraindre les
étudiants à participer.
Surmonter les obstacles juridiques et culturelsLa
crainte de dépasser les limites légales constitue un obstacle courant à
la mise en œuvre de telles réformes. Actuellement, les universités
hésitent à violer la confidentialité, même dans des situations
critiques, de peur de trahir la confiance et la vie privée et de
déclencher des poursuites judiciaires. L'inscription du système de
retrait dans la loi, qui comprendrait les principales mesures énumérées
ci-dessus, donnerait aux établissements la clarté et la confiance
nécessaires pour agir de manière décisive, garantissant ainsi la
cohérence dans l'ensemble du secteur. Sur le plan culturel, les
universités doivent répondre au scepticisme potentiel en engageant le
dialogue avec les étudiants, le personnel et les familles sur les
objectifs et les garanties du système.
La nécessité d’une action législative
Pour
garantir la mise en œuvre réussie d’un système de consentement par
refus, des mesures décisives sont nécessaires de la part du gouvernement
et des établissements d’enseignement supérieur. Le gouvernement doit
prendre l’initiative en légiférant sur l’introduction de ce système,
créant ainsi une approche cohérente à l’échelle du secteur pour
préserver le bien-être des étudiants. Sans action législative, les
universités resteront hésitantes, manquant de la clarté juridique et de
la confiance nécessaires pour adopter un modèle aussi audacieux.
La
législation est le seul moyen de garantir que chaque étudiant, quel que
soit l’endroit où il étudie, bénéficie du même niveau élevé de
protection, mettant fin à la loterie actuelle des codes postaux dans les
pratiques de protection dans l’ensemble du secteur.
Un appel à l’action collective
Les
universités ne doivent cependant pas attendre sans rien faire que la
législation prenne forme. Elles ont l’obligation morale de commencer dès
maintenant à combler les lacunes de leurs systèmes de notification des
prestations sociales. En élargissant ou en introduisant des systèmes
d’adhésion volontaire comme mesure provisoire, les établissements
peuvent commencer à combler ces lacunes, à recueillir des données
essentielles et à affiner leurs pratiques en prévision d’une transition
sectorielle.
Les
universités devraient s’unir au sein d’organismes sectoriels pour faire
pression sur le gouvernement en faveur d’une réforme législative,
démontrant ainsi leur engagement collectif à protéger les étudiants. En
outre, les établissements doivent engager leurs communautés – étudiants,
personnel et familles – dans un dialogue transparent sur les avantages
et les garanties du modèle de retrait, garantissant une large base de
compréhension et de soutien pour sa mise en œuvre éventuelle.
Cette
double approche, qui associe une action institutionnelle immédiate à
une réforme législative à long terme, constitue une voie pragmatique et
proactive. Les universités peuvent commencer à sauver des vies dès
aujourd’hui tout en jetant les bases d’un cadre de protection solide,
cohérent et juridiquement soutenu pour l’avenir.
Établir une nouvelle norme pour la protection des étudiants
La
crise croissante de santé mentale chez les étudiants exige plus que de
la bonne volonté institutionnelle : elle nécessite un changement
systémique. Bien que le taux de suicide parmi les étudiants de
l’enseignement supérieur soit inférieur à celui de la population
générale, cela ne doit pas être un motif de complaisance. Chaque perte
est une tragédie profonde et un signal clair que des améliorations
systémiques sont nécessaires de toute urgence pour sauver des vies. Les
établissements d’enseignement supérieur ont le devoir de donner la
priorité au bien-être des étudiants et doivent s’assurer que leurs
environnements offrent les normes de sécurité et de soutien les plus
élevées. Un système de consentement de retrait pour les contacts avec
les services sociaux n’est pas une panacée, mais il représente une étape
essentielle vers la création d’environnements universitaires plus sûrs
et plus favorables.
Le
secteur de l’enseignement supérieur reconnaît depuis longtemps
l’importance du bien-être des étudiants, mais ses cadres actuels restent
fragmentés et réactifs. Cette proposition est à la fois audacieuse et
réalisable. Elle s’aligne sur les tendances sociétales en faveur d’une
protection proactive, reflète une approche bienveillante du bien-être
des étudiants et offre un mécanisme juridiquement solide pour prévenir
de futures tragédies.
Le
suicide de 64 étudiants en une seule année universitaire est un rappel
brutal de l’échec du statu quo. En adoptant un système de consentement
libre et éclairé, les universités peuvent créer une culture de soins qui
sauve des vies, soutient les familles en deuil et remplit son devoir de
protection des étudiants.
Il
est temps d’agir. Avec le soutien du législateur et l’engagement de
l’ensemble du secteur, cette réforme pourrait devenir la pierre
angulaire d’une réponse nationale plus humaine et plus efficace à la
prévention du suicide chez les étudiants.
https://www.hepi.ac.uk/2025/02/10/a-legislative-solution-to-student-suicide-prevention-advocating-for-opt-out-consent-in-response-to-student-welfare-concerns/