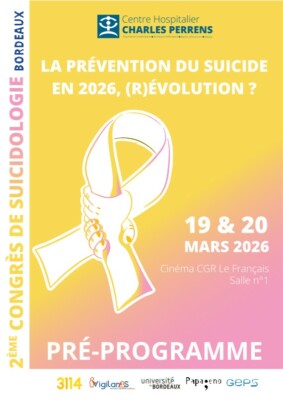E-Journal-Club
en suicidologie,
une rencontre mensuelle en ligne consacrée à la recherche en suicidologie et
accessible à tous ceux intéressés par le sujet - chercheurs, soignants,
administration, bénévoles d'association. L'événement est co-organisé par l'UNPS
et Fabrice
Jollant
"Un moment sympa de science partagée, égalitaire et citoyenne."
prochain :
mardi 6 janvier 2026 à 18h30
Fanny Larue
Coordinatrice du Collectif
deuilS et Chargée de projet dans l'association Empreintes,
qui nous présentera:
Enseignements clés de l’étude
Crédoc/Empreintes 2025
"Les Français face au
deuil"
Résumé:
Eclairage
synthétique sur le deuil en France aujourd’hui, à partir des enseignements
essentiels de l’étude 2025 "Les Français face au deuil" menée
par Empreintes, le Crédoc et le SAF. La présentation mettra en avant des
données récentes sur les impacts du deuil dans la vie quotidienne, notamment
sur l’augmentation des consommations (alcool, tabac, alimentation), sur
la durée et l’intensité des vécus de deuil, ou encore sur la santé mentale (épisodes
dépressifs, pensées suicidaires, trouble du deuil prolongé ...).
Et
comme chaque semaine, cela se passe uniquement en visio et ici.
***
Historique du E-Journal :
La
première session de la saison 2025-2026 a eu lieu le mercredi
3 septembre 2025 de 18h à 19h30,
e-Journal-Club
en suicidologie avec Benoit CHALANCON de Lyon pour une session
consacrée à la recherche sur le plan de protection ("safety
plan").
Première partie : «
Le Plan de Protection : traduction et mesure de l’efficacité en contexte
français, et modalités de mise en œuvre ». présentation du protocole et présentation de l' étude de Hollenberg sur les modalités de mises en œuvre.
- Chalancon, B.,
Haesebaert, J., Vacher, A., Vieux, M., Simon, L., Subtil, F., Colin, C.,
Poulet, E., Leaune, E., Investigator Associates, Almeida, S., Barasino, O.,
Benoist, M., Boudin, P., Bastard, E., Bussière Lheureux, M., Dalmont, J.,
Denes, D., Dubois, F., … Vernet, T. (2025). Implementing a nurse-led safety
planning intervention in emergency departments to prevent suicide reattempts : A stepped-wedge randomized
controlled trial protocol (French multicentre randomized controlled trial with
a stepped-wedge design). BMC Nursing, 24(1). https://doi.org/10.1186/s12912-025-03121-w
- Chalancon, B.,
Leaune, É., Vacher, A., Vernet, T., Vieux, M., Lau-Taï, P., Bislimi, K., &
Poulet, E. (2025). La traduction et l’adaptation françaises de l’« intervention
de planification de la sécurité » pour la prévention des tentatives de suicide
: une méthode en quatre étapes. L’Encéphale, S0013700625000107. https://doi.org/10.1016/j.encep.2024.11.018
- Hollenberg, E.,
Shin, H. D., Reid, N., Stergiopoulos, V., Lestage, L., Nicoll, G., Walji, A.,
& Zaheer, J. (2025). Contexte, timing et soins individualisés : une
évaluation réaliste de la planification de la sécurité pour les personnes
souffrant de pensées et de comportements suicidaires, leurs familles et amis,
et les prestataires de soins. Journal of Clinical Medicine, 14(12), 4047. https://doi.org/10.3390/jcm14124047
La seconde partie
sera consacrée à une revue de littérature sur les mécanismes d’action (non
publiée mais présenté à la IASP) en français pour une meilleure accessibilité.
- Milner, A., Spittal, M. J.,
Kapur, N., Witt, K., Pirkis, J., & Carter, G. (2016). Mécanismes des
interventions brèves de contact dans les populations cliniques : une revue
systématique. BMC Psychiatry, 16, 194. https://doi.org/10.1186/s12888-016-0896-4
Présentation avec les articles en anglais et en français ainsi que le plan de protection.
C'est
ici dans la Dropbox du e-Journal-Club: https://www.dropbox.com/scl/fo/eo60l8nuds74t96roq0ft/APl0Z7xinuimiDImfH6Zu48?rlkey=7zvfj8vg4257fh2b9tvhwo2ds&st=ylmzjcm1&dl=0
Vous
pouvez retrouver tous les documents des précédentes sessions ici: Dropbox
-
E-Journal-Club en suicidologie, mardi 6 mai, 17h30 à 18h30, Marie-Claude GEOFFROY, professeure à l'Université McGill de Montréal, sur le thème "L’apport des études longitudinales à la recherche sur la prévention du suicide chez les jeunes" Marie-Claude synthétisera plusieurs de ses importants travaux.
-
E-Journal-Club le mercredi 2 avril à 18h, Dr Alice DEMESMAEKER du CHU de Lille nous présenter 2 de ses travaux qui nous permettront d'aborder la question majeure de l'état de stress post-traumatique:
- Demesmaeker A, Creupelandt C, Leroy A, Vaiva G, D’Hondt F. Impact of posttraumatic stress disorder and comorbid psychiatric conditions on suicide reattempts. Eur J Psychotraumatol. 2025;16(1):2461435.
- Demesmaeker A, D’Hondt F, Amad A, Vaiva G, Leroy A. Posttraumatic Stress Disorder and Risk of Suicide Reattempt in the French ALGOS Study. J Clin Psychiatry. 2024;85(4):24m15269.
Articles dans la Dropbox du eJC
ici.
-
E-Journal-Club en suicidologie, mercredi 5 mars à 18h
Dr Matthieu GASNIER présenter 2 articles avec un focus sur l'infection à COVID:
- Gasnier, M., et al. 2022. Comorbidity of long COVID and psychiatric disorders after a hospitalisation for COVID-19: a cross-sectional study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. jnnp–2021. 10.1136/jnnp-2021-328516
- Gasnier, M., et al. 2024. Acute COVID-19 severity markers predict post-COVID new-onset psychiatric disorders: A 2-year cohort study of 34,489 patients. Mol Psychiatry.
- E-Journal-Club en suicidologie Jeudi 6 février à 18h Professeure Mathilde HUSKY de l'unité INSERM U1219, Bordeaux Population Health Research Center, et de l'Université de Bordeaux, qui a présenté 2 de ses publications récentes, l'une sur la communication des idées suicidaires, un élément essentiel de la recherche d'aide, et l'autre sur la prévalence des idées suicidaires chez les jeunes entre 2000 et 2021, à partir des données du Baromètre Santé.
articles :
- Husky MM, Léon C, Vasiliadis HM. Increases in suicidal thoughts disclosure among adults in France from 2000 to 2021. J Affect Disord. 2025 Feb 15;371:54-60. doi: 10.1016/j.jad.2024.11.042. Epub 2024 Nov 17. PMID: 39561924.
- Husky MM, Léon C, du Roscoät E, Vasiliadis HM. Prevalence of suicidal thoughts and behaviors among young adults between 2000 and 2021: Results from six national representative surveys in France. Psychiatry Res. 2024 Mar;333:115763. doi: 10.1016/j.psychres.2024.115763. Epub 2024 Feb 1. PMID: 38325160.
-
E-Journal-Club en suicidologie mercredi 8 janvier 2025 - 18h30. Pr Fabrice JOLLANT, MD PhD a présenté un Best-of d'articles publiés en 2024.
- E-Journal-Club en suicidologie 4
décembre 2025 de 18h.
Dr Ariel Frajerman sur le sujet de la santé mentale des étudiants en médecine en France.
Articles
-
Frajerman et al. Depression and suicidal thoughts in medical students
and the general population: A comparison from 2 national studies. Gen
Hosp Psy 2024
- Vergeron et al. Use of service and treatment
adequacy in medical students and residents suffering from depression in
France: A nationwide study. Psy Res 2024
- Rolland et al. Mental health and working conditions among French medical students: A nationwide study. JAD 2022
-
e-Journal club en suicidologie mercredi 6 novembre 2024 à 18h,
Présentation du Dr Alexis Vanhaesebrouck de 2 articles sur le suicide en prison en France, état des lieux actualisé et identification des facteurs de risque.
Les articles sont : - Vanhaesebrouck et al. Suicide following a conviction, solitary confinement, or transfer in people incarcerated: A comprehensive retrospective cohort study in France, 2017–2020. Suicide Life threatening Behavior 2024
- Vanhaesebrouck et al. Risk factors of suicide in prisons: a comprehensive retrospective cohort study in France, 2017–2020. Risk factors of suicide in prisons: a comprehensive retrospective cohort study in France, 2017–2020. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2024.
***
7/10/24 COMPTE RENDU DU 1er e-journal club en suicidologie qui a eu lieu le mercredi 2 octobre
https://www.dropbox.com/scl/fo/5p5mjl0v86k2ftdxkento/ABMLEbjCbVb31iZYzQdQdyI?rlkey=ln661vi3kkxj3hhvtcasx8rns&e=1&st=lrthcyi2&dl=0
***
Historique
1/10/24
=Chers
tous,
Je
vous rappelle le lancement du e-Journal-Club en Suicidologie, un moment
de partage convivial des connaissances scientifiques en suicidologie, ouvert à
tous.tes celles et ceux intéressé.e.s, en ligne et gratuit, et francophone. Ce
sera une fois par mois, le premier mercredi du mois de 18h à 19h (heure de
Paris).
La
1ere séance aura lieu demain, mercredi 2 octobre 2024 à 18h. Le lien
Teams est ici
Pour
cette première séance, je présenterai deux articles publiés avec Christophe
Leon de Santé Publique France, tous deux utilisant les données du Baromètre
Santé:
-
Jollant F, Hawton K, Vaiva G, Chan-Chee C, du Roscoat E, Leon C.
Non-presentation at hospital following a suicide attempt: a national survey.
Psychol Med. 2022
-
Jollant F & Leon C. Suicidal transition rates and their predictors in the adult
general population: a repeated survey over 21 years in France. Eur Psychiatry.
In press.
Notez
dès à présent les prochaines dates:
2024: 6 novembre, 4 décembre
2025: 8 janvier, 5 février, 5 mars,
2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet
***
1er post : le 16/09/24 :
Création
du e-Journal Club en Suicidologie.
L'objectif est de permettre à toutes et tous impliqués dans la prévention du
suicide d'accéder librement aux fruits de la science et de pouvoir en discuter
de manière multidisciplinaire.
Tous
les premiers mercredis du mois, sauf exception, nous présenterons en ligne durant 1 heure 2
articles scientifiques de suicidologie suivis d'une discussion de 10min par
article.
Fabrice
Jollant* aura l'honneur de présenter les 2 premiers articles
le mercredi 2 octobre de 18 à 19h, heure de Paris.
N'hésitez
pas à faire suivre l'information ainsi que le lien de connexion
L'accès
est gratuit. La discussion portera exclusivement sur les aspects scientifiques
et les applications pratiques éventuelles. Aucun cas particulier ne sera
discuté.
* Pr
Fabrice JOLLANT, MD PhD Professeur
des Universités - Praticien Hospitalier Université
Paris-Saclay, Faculté de Médecine &
Hôpital Bicêtre, APHP, service de psychiatrie Le
Kremlin-Bicêtre, FRANCE Adjunct
professor McGill
University, Department of Psychiatry &
McGill Group for Suicide Studies (MGSS), Douglas Institute Montréal,
CANADA