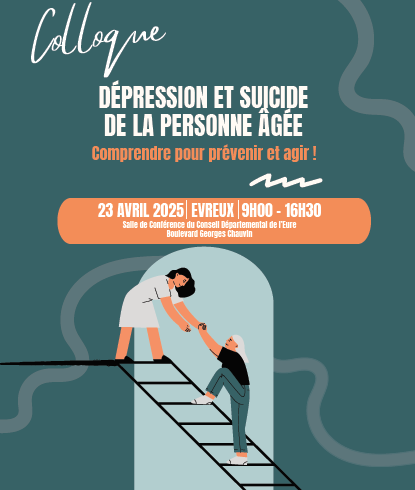Margaux Hazan, interne en psychiatrie et chercheuse en santé publique, responsable de cette enquête, s’est aussi appuyée sur un constat pour entamer ces travaux : « A l’hôpital ou au sein des services d’urgences, nous rencontrons des hommes en dépression, souvent sévère. Cela contraste avec les soins de psychiatrie en ville, où Doctolib comptabilise deux tiers de patientes parmi les prises de rendez-vous chez un psychiatre. » De quoi s’interroger sur les raisons de cet écart, et sur une possible arrivée des hommes à un stade plus avancé de leur pathologie.
Les patients, des « cochercheurs »Des hommes et des femmes déprimés vont donc être interrogés en nombre. Ils appartiennent à la cohorte ComPaRe (Communauté de patients pour la recherche) de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. La plateforme compte déjà plus de 5 000 inscrits sur son volet « dépression », mais elle aimerait en rassembler davantage, et rééquilibrer le nombre d’hommes, qui représentent pour l’heure seulement 20 % des participants. « ComPaRe Dépression est vraiment un dispositif de recherche participative. Chaque étude implique au moins deux patients comme cochercheurs », explique Astrid Chevance, psychiatre qui travaille au côté de Margaux Hazan au sein du Centre de recherche en épidémiologie et statistiques (Cress).
En sus des professionnels (des psychiatres, mais aussi des sociologues, par exemple), deux hommes déprimés comptent parmi les dix membres du comité scientifique qui a élaboré les questionnaires utilisés pendant l’étude. Son but principal vise à déterminer l’existence, ou non, de symptômes spécifiques de la dépression chez les hommes.
90 symptômes listés pour affiner les diagnosticsPour y parvenir, 90 symptômes ont été listés. Certaines émotions comme la tristesse, mais d’autres aussi, comme l’irritabilité. Des éléments davantage d’ordre comportemental, à l’instar du recours à des substances psychoactives (alcool, tabac…), ou encore des difficultés dans les relations aux autres, et des symptômes sexuels.
Tous dans des échelles d’analyse les plus fines possibles : « Nous ne limitons pas la question de la sexualité à la perte de libido, par exemple, illustre Astrid Chevance. En interrogeant les patients sur ce grand nombre de manifestations possibles de la dépression, l’idée consiste à déterminer si certaines sont plus saillantes chez les hommes, mais aussi comment elles s’agencent entre elles et s’articulent avec des variables comme l’âge, le statut socio-économique… »
Chez les femmes, le rôle des variations hormonales
Des études sur les différences symptomatologiques ont déjà été réalisées dans les années 1970 par les Anglo-Saxons, rappelle Margaux Hazan. Elles pointaient la présence de symptômes plus externalisés dans les dépressions masculines, comme l’agressivité et l’irritabilité ou la présence de conduites addictives. De son côté, la psychiatre Lucy Joly, coauteur avec Hugo Bottemanne de La Dépression au féminin (Éditions du Rocher, septembre 2024), relève la présence de symptômes dépressifs spécifiques chez les femmes : l’augmentation de l’appétit, le besoin de dormir davantage, les ruminations, les douleurs corporelles… Elle observe aussi chez elles davantage de rythmicité des symptômes, notamment du fait des variations hormonales, et un plus gros risque de rechuter et de voir la dépression devenir chronique.
Une fois la spécificité des symptômes mieux précisée, les chercheuses indiquent que les résultats de l’étude pourront être rapidement utilisés de façon opérationnelle en pratique clinique. Mais aussi en recherche, puisque des échelles plus sensibles à la dépression masculine pourront voir le jour et affiner les travaux sur la prévalence, autrement dit le nombre de dépressions. Sans oublier, invite Astrid Chevance, « la nécessaire levée du tabou de la santé mentale chez les hommes ».
Pour participer à l’étude, inscrivez-vous sur le site internet https://compare.aphp.fr/depression/