Ceux qui restent
Marie Laberge (Auteur) Paru le 4 mai 2016 Roman (broché)
En avril 2000, Sylvain Côté se suicide sans raisons apparentes, plongeant ses proches dans une douleur extrême. Des années plus tard, sa femme Mélanie s'accroche à leur fils Stéphane, son père Vincent s'est retiré du monde, sa mère Muguette a laissé échappé le peu de vie qui lui restait. Sa maîtresse, la barmaid Charlène, continue à lui parler en pensée. Un roman sur la douleur de l'absence.

Article sur le sujet
«La mort, ça exalte l’urgence de vivre»
Littérature Dans la polyphonie de «Ceux qui restent», Marie Laberge trouve l’harmonie de son passé de comédienne à sa passion de romancière. Interview.

09.07.2016 sur www.24heures.ch*
Comme son extravagante crinière blanche sur aile de corbeau, la Québécoise Marie Laberge échappe aux étiquettes. La sexagénaire s’impose en romancière au long cours avec notamment Le goût du bonheur , best-seller absolu. La chroniqueuse de l’intime laisse deviner une dramaturge pointue, elle qui fut directrice de théâtre, après avoir exercé en comédienne. Mais tonitrue aussi celle qui eut l’honneur de rédiger avec Gilles Vigneault, le préambule à la Déclaration d’indépendance du Québec il y a 20 ans. La citoyenne de la Belle Province a imposé une voix universelle. Et pas seulement quand cette artiste au fort tempérament empoigne la défense de sa langue natale, ou milite contre l’analphabétisme. Sur la palette émotionnelle de la femme de lettres, cinquante nuances de gris précisent le bruissement du monde. Son dernier roman, Ceux qui restent, organise la cacophonie laissée par le désastre d’un suicide. Sylvain s’est tué en 2000. Ses mère et père, sa veuve, son fils, sa maîtresse se confient. Leurs versions endeuillées tissent le temps passé, de trous de mémoires en cruelles béances. «J’aboutis certainement à l’amalgame le plus réussi de mes deux carrières. Des voix qui parlent avec verdeur, franchise, directement, comme on peut en entendre sur scène. Et le récit qui se précipite avec la narration qui fait avancer l’action, qui décrit les événements, change le rythme… Ma facette théâtrale a pu prendre sa pleine place dans ce roman. Mais elle n’est jamais loin, remarquez.»
Rieuse en société, grave face à la page blanche, Marie Laberge écrit à la plume Sheaffer, à l’ancienne, «dans le silence parfait». Tellement moderne ou plutôt, si intemporelle. «J’ai les tempes blanches. La vie m’a fait cette tête, et je ne la contredis pas.»
Imposer ce français enrichi de Québécois a-t-il été difficile?
Je ne le ressens pas comme une imposition. C’est un trésor à garder, plutôt qu’un combat. Et à cultiver. Je n’ai jamais vu un éditeur parisien comme une sorte de sommet à atteindre. Par contre, le lecteur français, belge, suisse romand etc. est un atout appréciable dans ma vie d’écrivaine. Depuis une trentaine d’années, je suis traitée comme une écrivaine avec une voix qui dit quelque chose, pas seulement une voix exotique qui chante différemment la langue.
Dans ce roman choral, quelle voix avez-vous préféré écrire?
Si, quand j’écris, je me trouvais aux prises avec une préférence, je serais bien malheureuse. J’aime mes personnages, contradictoires ou choquants. Chaque personnage doit me prendre en otage.
Quel est le distinguo entre les personnages qui disent «je», et les autres?
Ceux qui disent «je» parlent pour eux-mêmes, pas pour les autres. Et il fallait entendre les autres. Quand une femme comme la mère, Muguette, cultive le déni, il n’est sûrement pas tentant pour elle de se livrer ou de se justifier. C’était à moi de la faire entendre. Au contraire, le père, Vincent, parle avec sa nouvelle foi, celle de la vérité. Et on peut dire qu’il l’avait évitée auparavant.
Auteur à succès, vous ne cédez pas à la facilité avec cette structure…
Est-ce qu’on possède jamais un public? Le succès n’est jamais assuré, jamais. Les lecteurs sont un cadeau, qui peut aussi ne pas être au rendez-vous. Les lecteurs me demandent une seule chose, je crois: persévérer, et ne pas laisser la crainte de ne pas être aimée censurer mon écriture. Camus disait cette phrase que j’adore: «Ceux qui écrivent obscurément ont bien de la chance; ils auront des commentateurs. Les autres n’auront que des lecteurs, ce qui, paraît-il, est méprisable». Je ne pense pas aux lecteurs quand j’écris mon premier jet: ça se passe entre moi et la poubelle. Après, quand je corrige — et dieu sait si je corrige! — je ne pense qu’à eux. Est-ce clair, limpide… les mille questions et doutes.
Pourquoi revenir au suicide à ce moment de votre expérience?
Ce n’est pas le suicide qui m’intéresse, ce sont les gens qui doivent vivre avec la conclusion de quelqu’un qui a décidé de ne plus vivre. Parmi tous les abandons, celui du suicide est le plus terrible. Et il me semble qu’il a toujours fait partie de mon monde intérieur. Tout comme la mort en général. C’est un thème qui revient très souvent dans mes livres. Mais contrairement à ce qu’on croit, il peut parler de la vie. Chez moi, la mort exalte l’urgence de vivre.
Si vous vous passionnez pour les bruissements du monde, vous restez intemporelle. Un paradoxe?
Être à la mode ne m’intéresse pas. Être lue, oui. Mais je suis persuadée que l’un ne commande pas l’autre. Ce n’est pas la mode qui fait qu’on nous lit avec constance, mais ce que l’on dit, la vie dont on témoigne.
Ceux qui restent, de Marie Laberge, éd. Stock.
(Créé: 09.07.2016, 15h30)
http://www.24heures.ch/culture/mort-exalte-urgence-vivre/story/25623750

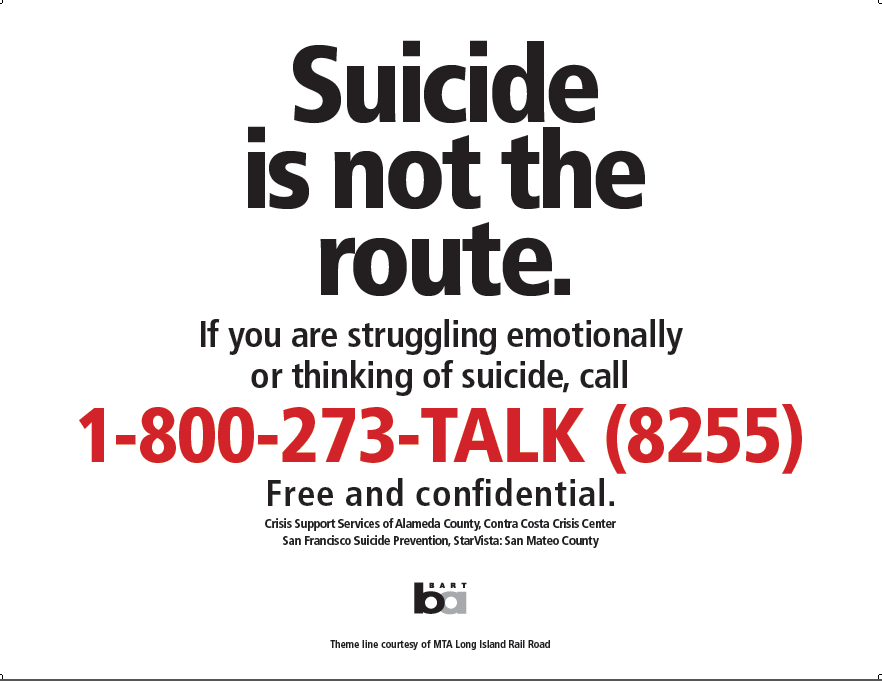
 Graffiti sur un bâtiment délabré à Detroit, Michigan.
Graffiti sur un bâtiment délabré à Detroit, Michigan.